Juin 2025 - Source Nicolas Bonnal

1968 marque la fin d'un certain occident démocratique caractérisé par des restes d'autorité, de hiérarchie, de tradition (relire Lipovetsky), et la naissance d'un foutoir occidental, caractérisé lui par une apparente anarchie masquant une tyrannie cybernétique (Debord la pressent dès 1963, voyez Bourseiller) et un néo-totalitarisme de marché qui reposera sur l'abrutissement des populations.
C'est là que deux grands films se rencontrent : le Play Time de Tati qui décrit la France remplacée-américanisée, une France disparue qui était déjà menacée par les américains dans Jour de fête (les bombardiers postaux humiliant le facteur Cheval...) et qu'on a fait peu à peu disparaître donc : on a eu Hulot (il suit un feld-maréchal allemand pour un pique-nique déjà...) et son apocalypse touristique puis Mon oncle, qui montre le procès de déshumanisation et d'américanisation initié par une bourgeoisie consentante et qui trouvera avec le gaullisme le cadre administratif et politique dont elle avait besoin (c'est ce que me disait ma grand-tante coco quand j'étais enfant et je me rends compte qu'elle avait raison). Tati avait d'ailleurs dit aux Cahiers que l'URSS avait fêté Mon Oncle parce que « la bourgeoisie en prenait plein la gueule ». Et Pasolini de passage en URSS avait vanté une société sans classe, vraiment égalitaire, infiniment plus sympathique que la Moscovie cybernétique et ploutocrate actuelle.
Rappel.
Dans Play Time la France a réellement disparu, le monde a été unifié (pensez à Brasilia et à Belmondo perdu dans ses échafaudages) : il ne reste que des bribes-reflets de France, le copain du régiment, la touriste souriante ; le reste regarde la télé ou circule en bagnole en attendant les zones à faible émission. On va passer de Jean Gabin à Jean Yanne en quelques années, sans que personne ne rechigne. L'image splendide de Tati, un des plus grands TECHNICIENS du cinéma, rend la pilule moins amère. Mais le monde est devenu une vitrine. Ô cette pub US vantant Hong-Kong, Paris, Londres et une même image de gratte-ciel. On découvrira avec soin la vidéo de Yannick Rolandeau qui dans une étonnante vidéo décrypte bellement les messages du film sur YouTube.
Mais on doit aussi parler de The Party. Les deux films sont de la même année et décrivent une belle entropie : la destruction d'une fête ; on a d'un côté un restau bourgeois qui va partir en quenouille (chez Tati) ; et de l'autre un hindou sympa et maladroit (ils ont changé depuis, ils sont au pouvoir aux USA, maîtres des ordinateurs et des administrations), qui précipite à la manière d'un clown guénonien une catastrophe soixante-huitarde dans une soirée huppée de la gentry hollywoodienne encore Wasp. Un monde s'écroule, celui de la « démocratie autoritaire » décrit par Lipovetsky donc. Au-delà de la blague et des gags, de rencontres romantiques va se mettre en place un monde plus sinistre et moins commode. Mais dans les deux films on sent une certaine jubilation à détruire la réalité capitaliste et autoritaire du moment. C'est une fête libératrice.
Tati fut enterré par l'échec de son film. Tout le contraire pour Peter Sellers. Plus grand acteur de l'époque, consacré par Kubrick dans deux grands films (Lolita et Folamour) Sellers a incarné à la perfection cette ère du cool décrite tant bien que mal par Thomas Frank dans un livre qui aurait pu être fondamental. Lancée par l'agence DDB (celle des pubs Volkswagen), la conquête du cool allait démolir ce qui restait du vieil édifice vermoulu. Houellebecq en a bien parlé dans ses particules élémentaires.
On attendait en tout cas une destruction créatrice qui comme d'habitude (merci Schumpeter) n'eut pas lieu.
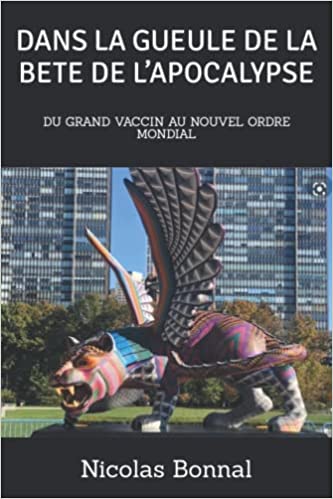 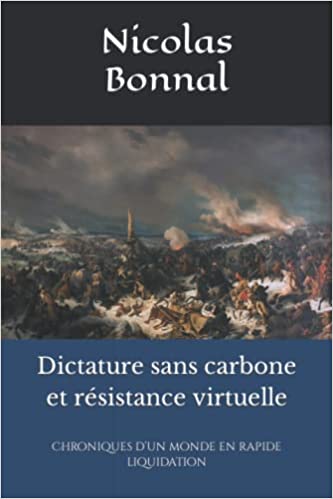 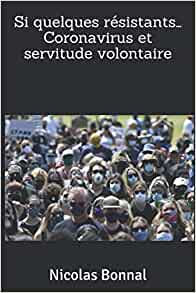 |
Sources