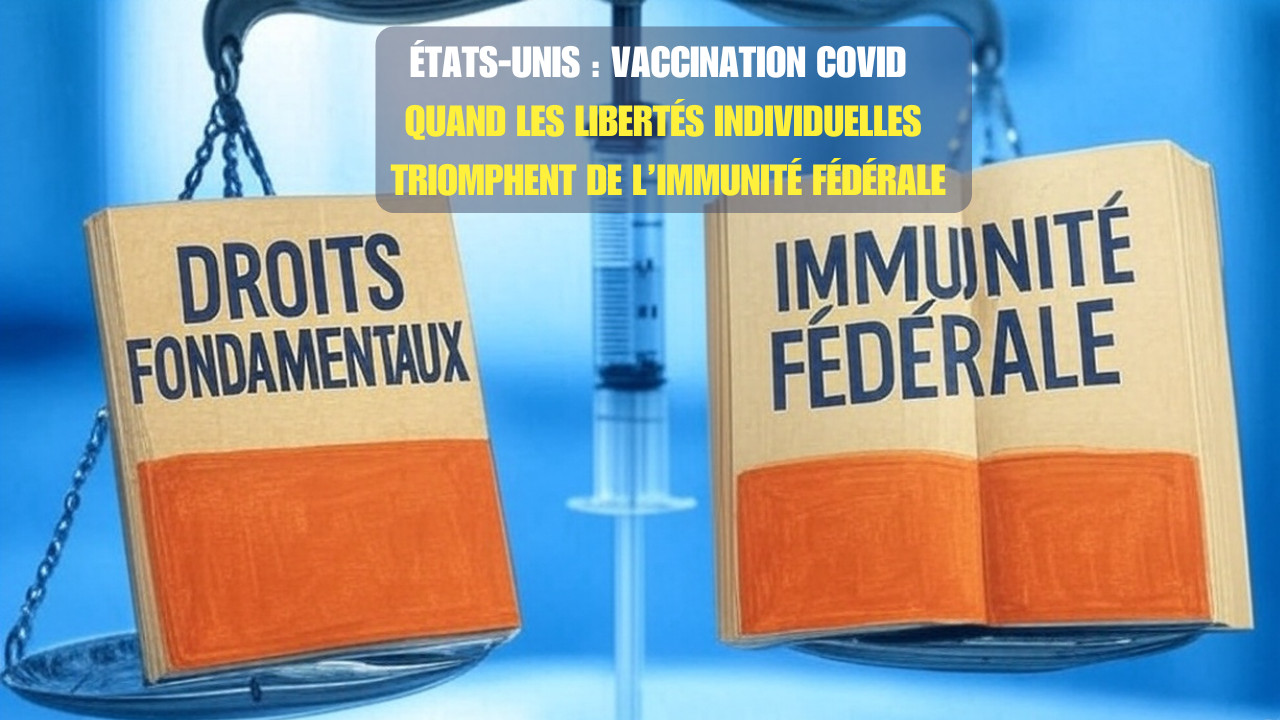Xavier Azalbert, France-Soir
Résistance et renaissance – Vers une humanité consciente
Ceci est la troisième et dernière partie d'un essai sur la relativité. La première partie portait sur l'humanité en quête de vérité, la seconde sur la confiscation de la vérité.
La capture des droits fondamentaux : un outil de contrôle
La crise sanitaire a révélé un mécanisme insidieux : la capture des droits fondamentaux comme outil de contrôle, consolidant le pouvoir d'une minorité au détriment de la majorité. Les confinements, les passes sanitaires, les obligations vaccinales, imposés au nom de la « santé publique », ont restreint des libertés essentielles – déplacement, travail, expression – sous prétexte d'urgence. En France, un indice mondial des politiques Covid a classé le pays parmi les « démocraties défaillantes », aux côtés de régimes autoritaires, en raison de mesures jugées liberticides, censure des voix dissidentes. Ces restrictions, souvent justifiées par des modèles scientifiques biaisés, ont transformé les droits en privilèges conditionnels, accordés ou retirés selon la conformité des citoyens.
Ce mécanisme n'est pas nouveau. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, décrivait comment le pouvoir moderne repose sur la discipline : contrôler les corps, les esprits, les comportements, sous couvert de bien commun. Pendant la Covid, les gouvernements ont utilisé la peur – peur du virus, peur de l'exclusion sociale – pour imposer une obéissance collective. Les passes sanitaires ont créé une société à deux vitesses : les « vaccinés », libres de voyager ou de travailler, et les « non-vaccinés », relégués au statut de parias. Cette discrimination a brisé la cohésion sociale, transformant les citoyens en surveillants les uns des autres – un panoptique moderne où chacun devient gardien de la norme.
À l'origine, les élus sont portés par des idéaux : servir le peuple, défendre la justice, promouvoir le bien commun. Mais la rente de situation – salaires élevés, privilèges, exposition médiatique – les pousse à oublier ces principes. En France, un député gagne 7 200 euros par mois, sans compter les avantages (logement, transport), une « place chaude » qui incite à privilégier la réélection sur l'intérêt général. Les confinements, prolongés sans débat parlementaire, illustrent cette dérive : des décideurs, protégés par leur statut, ont imposé des mesures dévastatrices pour les plus vulnérables – commerçants, précaires, jeunes – sans en subir les conséquences. Cette capture du pouvoir par une élite déconnectée consolide une minorité qui, comme le disait Robert F. Kennedy Jr., refuse de lâcher prise : « Résistez, résistez, car une fois qu'ils ont le pouvoir, ils ne veulent jamais le rendre. »
La résistance, cependant, émerge. La décision Happel v. Guilford, en limitant l'immunité des fabricants de vaccins, a rappelé que les droits fondamentaux – consentement, intégrité corporelle – priment sur les intérêts industriels. Les citoyens, par des actions judiciaires, des manifestations ou des médias alternatifs, défient cette emprise. Mais le combat est inégal : les lobbies, les médias mainstream, et les algorithmes amplifient les narratifs dominants, marginalisant les voix dissidentes.
La liberté, comme le bien et le mal, est relative : elle dépend de notre capacité à reconnaître les chaînes qui nous entravent et à lutter pour les briser, non par la force, mais par la raison et la solidarité.
Vers des solutions : relativiser pour avancer
L'histoire ne se réinvente pas : de la Covid aux ZFE, nous répétons les mêmes erreurs, comme si les leçons économiques, sociales et humaines restaient lettre morte. En 2020, j'écrivais que les confinements auraient « un coût sans pareil », avec des pertes d'emplois et une fracture sociale durables. Les chiffres l'ont confirmé : en France, le PIB a chuté de 8 % en 2020, et les inégalités se sont creusées, les 1 % les plus riches captant 20 % des richesses (INSEE, 2022). En 2021, je notais que la défiance citoyenne, exacerbée par des mesures opaques, marquerait un tournant irréversible. En 2022, j'analysais une bascule vers des économies locales, sans correction des déséquilibres structurels : les multinationales prospèrent, tandis que les artisans peinent. En 2025, ces constats résonnent encore : les ZFE, comme les confinements, privilégient des solutions technocratiques, ignorant les coûts humains – précarité, exclusion, méfiance.
Mais, la crise n'est pas une fatalité ; elle est une invitation à relativiser, à reconnaître les interconnexions entre corps, esprit et société. Les solutions résident dans l'humilité et la mémoire collective :
- Éducation critique : réformer l'école pour former des esprits libres, capables de questionner les modèles scientifiques, les narratifs médiatiques, et les métriques du succès. Trop souvent, le succès est mesuré par l'argent – PIB, salaires, profits – au détriment d'indicateurs humains : bien-être, cohésion sociale, liberté. Une éducation intégrant science, philosophie et éthique enseignerait que la richesse véritable réside dans les liens, la curiosité, la résilience. Le déclassement de la France comme « démocratie défaillante » nous rappelle l'urgence de cet éveil.
- Dialogue ouvert : créer des espaces où scientifiques, citoyens et philosophes débattent sans dogme, comme en Suède pendant la Covid. La jurisprudence Hertel (1998) nous y invite, rappelant que la science vit de controverses, non de consensus imposés. Les voix dissidentes, comme celles de Raoult, Perronne ou Bhattacharya, doivent être entendues, non censurées.
- Éthique humaine : reconnaître les biais cognitifs – peur, conformisme, avidité – qui déforment les politiques publiques. Les ZFE, comme les confinements, illustrent cette cécité, privilégiant des solutions autoritaires à des approches inclusives. Une éthique ancrée dans les droits fondamentaux, comme le montre Happel v. Guilford, protégerait les citoyens contre l'arbitraire.
- Respect de la finitude : intégrer les limites écologiques et humaines dans nos choix. La géo-ingénierie, comme les modèles climatiques biaisés, ignore cette réalité, préférant des chimères technologiques à des solutions ancrées – agriculture durable, circuits courts, sobriété Lien. L'IA peut organiser des données, mais seul l'humain, avec son intuition et ses doutes, donne du sens à ces limites.
- Mémoire collective : apprendre des crises passées. La Covid a montré les dangers de l'autoritarisme, de la défiance, de la capture des droits ; le climat nous enseigne l'urgence du dialogue ; l'économie nous rappelle la fragilité des liens sociaux. Avons-nous appris ? Les ZFE, les narratifs géopolitiques, et le déclassement démocratique suggèrent que non. Pourtant, l'histoire est un miroir : en la regardant avec humilité, nous pouvons choisir un autre chemin.
Le succès, trop souvent réduit à l'argent, doit être redéfini. Une société qui valorise les profits sur la santé, comme lors de la Covid, ou sur l'environnement, comme avec les ZFE, sacrifie son âme. Les métriques humaines – bonheur, liberté, solidarité – sont plus fragiles, mais plus vraies.
Comme le disait Aristote, « le bonheur est une activité conforme à la vertu » ; aujourd'hui, cette vertu réside dans notre capacité à relativiser, à reconnecter corps, esprit et société, à résister à la capture du pouvoir.
Une lumière dans l'ombre
Cette crise n'est pas celle d'un virus, mais celle de l'humanité face à ses illusions. Les confinements, fruits de modèles biaisés, ont confisqué la liberté au nom d'une science dogmatique. Les traitements précoces, étouffés par une propagande vaccinale, illustrent la capture de la vérité par les lobbies. Les droits fondamentaux, instrumentalisés comme outils de contrôle, ont consolidé une minorité avide de pouvoir. Les ZFE, les narratifs climatiques, les conflits géopolitiques prolongent ces dérives, hypnotisant les esprits par la peur, la pollution informationnelle et le corporatisme. L'IA, simple outil, ne sauvera pas l'humain : c'est à lui, avec son corps, son esprit, ses liens, de relativiser ses certitudes.
Gide l'écrivait : « Une pas assez constante pensée de la mort n'a pas donné assez de prix au plus petit instant de ma vie ». En 2025, souvenons-nous de notre finitude. Platon nous l'enseigne : nous sommes des ombres dans la caverne, mais en questionnant nos chaînes – scientifiques, médiatiques, économiques, politiques – nous pouvons entrevoir la lumière. La Suède, en choisissant la mesure face à la covid, a tracé une voie. Robert F. Kennedy Jr. nous l'a dit : « Résistez, résistez », car la liberté, une fois perdue, se regagne au prix d'une lutte acharnée.
À nous de suivre ce chemin, non par des machines, mais par la raison, la solidarité, et l'humanité, conscientes que tout – du corps à la planète – est interconnecté, relatif, et infiniment précieux.