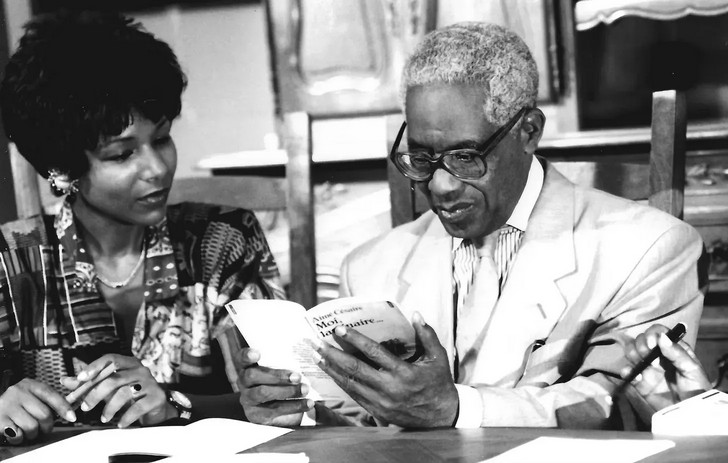
Par Mjriam Abu Samra, le 19 mai 2025
Repenser le rôle des universités libérales en Palestine
Malgré l'adoption généralisée d'un langage décolonial et l'accent rhétorique mis sur la décolonisation, les universitaires "progressistes" ou "libéraux" ont souvent échoué à aligner leurs pratiques sur les transformations radicales qu'ils prétendent défendre.
Si les actions des universitaires "conservateurs" ou "traditionnels" - qui s'efforcent clairement de faire taire les voix palestiniennes et protéger le statu quo politique et culturel - sont évidentes, une évaluation critique du rôle joué par le monde universitaire libéral au cours de l'année écoulée fait encore défaut.
En Europe notamment, les espaces universitaires libéraux ne parviennent souvent pas à amplifier véritablement les voix décoloniales ni à intégrer leurs perspectives au premier plan du discours scientifique.
Les événements et les discussions universitaires organisés au cours de l'année écoulée reflètent souvent les points de vue formulés au sein des centres de pouvoir d'une grande partie du monde dit occidental, mettant l'accent sur des cadres qui risquent de renforcer les récits coloniaux et de marginaliser les critiques et les aspirations palestiniennes.
L'absence d'un soutien cohérent et structuré aux étudiants palestiniens et aux intellectuels engagés politiquement a entravé le développement d'initiatives cohésives et percutantes. Ces incohérences révèlent que, sans une adhésion totale aux pratiques décoloniales, l'engagement autoréférentiel en faveur d'un changement transformateur reste au mieux superficiel ou une manœuvre performative qui, en fin de compte, maintient le statu quo.
Cette incohérence est dangereuse car elle risque de diluer le potentiel radical de la décolonisation, la réduisant à un terme néolibéral à la mode qui peut sembler progressiste, mais qui, en fin de compte, maintient le statu quo.
Les limites du monde universitaire libéral : la désobéissance épistémique comme pratique décoloniale
La décolonisation n'est pas seulement un concept intellectuel. C'est un processus qui nécessite un changement fondamental dans la manière dont le savoir est produit, partagé et valorisé.
Elle remet en question les rapports de pouvoir existants en mettant l'accent sur le rôle central des cadres épistémiques et des expériences du Sud. La décolonisation consiste à remettre en question non seulement le contenu du savoir, mais aussi les structures de pouvoir qui déterminent qui le produit et quelles expériences sont au centre du processus.
La décolonisation passe par une remise en question critique du fonctionnement du pouvoir à travers les discours qui définissent et régulent le savoir. Comme nous l'a enseigné Foucault, le savoir n'est jamais neutre. Il est toujours imbriqué dans des relations de pouvoir qui déterminent ce qui est considéré comme légitime, qui est autorisé à l'articuler, et comment ce savoir devient hégémonique.
Historiquement, le projet colonial ne s'est pas limité à une conquête matérielle et politique, mais a également été épistémique, établissant le savoir occidental comme universel tout en soumettant et en marginalisant les épistémologies non occidentales. Cette violence épistémique persiste à travers les disciplines universitaires qui institutionnalisent les modes de connaissance occidentaux comme objectifs et scientifiques, reléguant les systèmes de savoir autochtones à la marge.
Foucault explique en outre que le pouvoir s'exerce non seulement par la coercition, mais aussi par la normalisation de régimes de vérité particuliers. Dans le domaine de la production de connaissances, cela signifie que les épistémologies dominantes ne sont pas simplement imposées, mais qu'elles sont intériorisées comme des cadres de réflexion naturels et incontestés.
Le langage et les définitions validés en tant que références universelles reflètent la relation intrinsèque entre le pouvoir et la production de connaissances. La nomenclature utilisée pour décrire les régions du monde, telle que "Sud global", "Moyen-Orient" ou "tiers monde", n'est pas simplement descriptive, mais le produit de processus historiques et politiques enracinés dans le colonialisme et l'impérialisme. Ces termes renforcent les hiérarchies épistémiques qui privilégient les perspectives géopolitiques euro-américaines, maintenant un ordre mondial dans lequel la connaissance est principalement produite dans les "pôles" universitaires occidentaux, tandis que les soi-disant "périphéries" restent des lieux d' extraction plutôt que de production.
Cette dynamique façonne de la même manière la manière dont la question palestinienne est présentée et débattue dans le monde universitaire. La persistance de termes tels que "conflit" pour décrire les relations entre la Palestine et Israël fait abstraction des structures de pouvoir coloniales au cœur de la lutte palestinienne et contribue plutôt à maintenir les notions occidentales de "neutralité".
Au cours de l'année écoulée, ce déséquilibre épistémique a été encore davantage mis en évidence par un débat paradoxal visant à déterminer si le massacre de Gaza relève du "génocide", une décision dictée une fois de plus par des normes eurocentriques, même dans les milieux universitaires.
La décolonisation exige donc un acte de désobéissance épistémique, c'est-à-dire le rejet conscient des structures de savoir imposées et la revendication d'épistémologies alternatives qui ont été systématiquement effacées ou délégitimées.
Ce processus nécessite des transformations structurelles au sein des institutions qui régissent la production du savoir, en premier lieu le monde universitaire. La décolonisation ne consiste pas simplement à diversifier la norme ou à intégrer des perspectives non occidentales dans les cadres existants ; elle nécessite une restructuration fondamentale des mécanismes qui déterminent ce qui est considéré comme savoir.
Cela implique de repenser les méthodologies de recherche qui positionnent souvent les communautés du Sud comme des objets d'étude plutôt que comme des producteurs de connaissances ; un processus qui a vu les Palestiniens figurer parmi les " cas les plus étudiés" au cours des dernières décennies, renforçant ainsi la dynamique consistant à "parler au nom" des subalternes. Et l'année dernière a été marquée par un accroissement notable de cette tendance.
Une décolonisation sans les colonisés ? La contradiction structurelle du monde universitaire
En ne prenant pas pleinement conscience de cette réalité, les universitaires libéraux risquent non seulement de perpétuer une forme superficielle de décolonisation - qui reprend le langage de la théorie décoloniale sans remettre véritablement en cause les structures coloniales qui sous-tendent la lutte palestinienne -, mais aussi de permettre au projet colonial de prospérer sous cette apparence trompeuse.
Sous cette façade prétendument progressiste se cache la décadence de la véritable pensée révolutionnaire, qui permet aux modes de pensée coloniaux de se propager et de saper les luttes politiques authentiques tout en donnant l'apparence d'une réforme.
Cette déconnexion théorique est illustrée par l'incapacité à mettre en avant de manière significative les intellectuels engagés ou, pour reprendre un concept fondamental de Gramsci, les intellectuels "organiques".
Alors que le monde universitaire progressiste a souvent proclamé l'importance de créer un espace pour l'analyse autochtone et les voix intellectuelles subalternes issues de la base, les discours radicaux émergeant des mouvements palestiniens ont été marginalisés dans de nombreux événements et conférences universitaires organisés au cours de l'année et demie écoulée.
Les concepts théoriques, les schémas intellectuels et les préoccupations des universitaires "traditionnels" - pour reprendre encore une fois Gramsci - sont souvent privilégiés, reflétant davantage la tradition universitaire libérale occidentale que les schémas discursifs issus de l'analyse décoloniale et des perspectives de libération du Sud.
Par exemple, malgré les critiques croissantes des universitaires palestiniens sur les limites et les contradictions du système normatif international, seules quelques rares tribunes ont donné la parole à cette analyse, tandis que de nombreux débats universitaires ont continué à se concentrer sur la manière dont le droit international et les institutions internationales constituent le cadre principal pour faire avancer la cause palestinienne.
Cette focalisation reflète une tradition intellectuelle qui privilégie le rôle du droit international en tant que mécanisme de résolution des conflits, tout en ignorant les critiques émanant du mouvement palestinien - et plus largement des universitaires du Sud - qui considèrent ces cadres juridiques comme partie intégrante du projet colonial.
Cela implique que les analyses produites dans ces espaces reflètent des préoccupations canoniques et disciplinaires (souvent d'origine occidentale) ainsi que des cadres épistémiques et pédagogiques, plutôt que les réalités vécues et les traditions intellectuelles des Palestiniens. Le potentiel décolonial de ces discussions est donc très limité.
Cette incapacité à donner la parole aux voix "organiques" dépasse le cadre intellectuel et s'étend aux approches organisationnelles au sein même du monde universitaire. On a peu dialogué avec les mouvements étudiants palestiniens émergents et la nouvelle génération d'intellectuels palestiniens, qui développent leurs propres langages, récits et pratiques de décolonisation.
Dans de nombreux cas, l'approche du monde universitaire libéral a été condescendante, reproduisant les mêmes dynamiques de pouvoir colonial, sexiste et générationnel qui sont critiquées dans les systèmes universitaires "conservateurs" : des dynamiques qui permettent et renforcent des relations de pouvoir déséquilibrées où le savoir est principalement produit à l'image des visions et des approches de la classe dominante, ou des intellectuels "traditionnels" (y compris les universitaires palestiniens qui continuent d'adhérer à ces cadres et de les renforcer).
Plutôt que de laisser la place à de nouvelles voix engagées pour faire évoluer le discours, le monde universitaire impose ses propres cadres, ses propres hypothèses et ses propres traditions intellectuelles, rejetant les idées émergentes comme un anti-intellectualisme contestataire.
Si elle ne parvient pas à écouter et à dialoguer avec ces nouvelles voix, la sphère universitaire libérale risque de saper le potentiel transformateur de l'épistémologie décoloniale qu'offrent à la fois le moment présent et ses praticiens décoloniaux. Comme nous le rappelle Fanon, la décolonisation ne peut être comprise et réalisée qu'en " discernant les mouvements qui lui donnent forme et contenu historiques".
Au cœur de cette critique réside la reconnaissance que, sans un processus sérieux d'autocritique, le monde universitaire libéral risque de faire plus de mal que de bien.
En dissociant les pratiques de ce qui est professé dans les salles de classe et dans les écrits, on risque de diluer le sens profond de la décolonisation, de saper la cause palestinienne et d'entraver la transformation radicale du système qui est déjà en cours. Pire encore, cela pourrait contribuer à légitimer les structures mêmes du pouvoir et de la domination que nous cherchons à démanteler.
La pédagogie révolutionnaire en pratique : le devoir académique de s'engager
Il est impératif que les universitaires progressistes s'engagent de manière plus honnête, plus rigoureuse et plus soutenue en faveur de la cause palestinienne. Par exemple, lors d'une conversation, un membre de l'organisation italienne "Scholars for Gaza" a suggéré que les universitaires devraient réévaluer leur rôle :
"Il ne s'agit pas de publier des livres sur 'la situation actuelle et les solutions décoloniales' d'un point de vue occidental. L'objectif devrait être de traduire et de diffuser les travaux universitaires anciens et nouveaux, palestiniens et autochtones, qui appellent à des 'solutions' décoloniales et les articulent, et qui ont été ignorés ou rejetés pendant des décennies".
En outre, plaider en faveur de l'octroi de bourses aux étudiants palestiniens ne peut être la seule stratégie universitaire pour lutter contre le scholasticide tant qu'il n'y a pas d'engagement institutionnel cohérent avec les universités palestiniennes.
Appeler à une "rupture" avec les pratiques de la "pédagogie néolibérale" en misant sur des gestes symboliques comme la journée "keffieh" organisée dans plusieurs pays européens n'est pas suffisant si, par exemple, les enseignants ne sont pas en mesure de soutenir les actions étudiantes, d'adhérer pleinement aux appels à la grève et d'apporter un soutien clair aux revendications et aux pratiques des étudiants qui font avancer le discours révolutionnaire sur la Palestine dans leurs campus.
Cette question est plus que jamais d'actualité, à l'heure où l'on peut envisager concrètement un véritable engagement avec le monde universitaire palestinien, à la suite de l'accord de cessez-le-feu et de la possibilité de reconstruire et de maintenir les universités et l'ensemble du système éducatif à Gaza.
Les universitaires d'aujourd'hui ne peuvent passer à côté de cette occasion unique de s'engager dans un processus véritablement transformateur de décolonisation du savoir. Il est important de s'engager dans un processus épistémologique qui non seulement remet en question les discours dominants, mais examine aussi de manière critique le rôle des universités libérales au sein des structures du savoir et du pouvoir.
Ce n'est qu'en interrogeant de manière critique les fondements ontologiques et épistémologiques des systèmes de savoir dominants que la décolonisation émerge non pas comme un exercice rhétorique, mais comme une praxis, un impératif matériel et intellectuel pour parvenir à une articulation contestataire de la pédagogie révolutionnaire. Car, comme nous l'a rappelé Paulo Freire,
"aucune pédagogie véritablement libératrice ne saurait s'éloigner des opprimés en les traitant comme des misérables à qui l'on donne pour modèles ceux qui les oppriment".
Traduit par Spirit of Free Speech