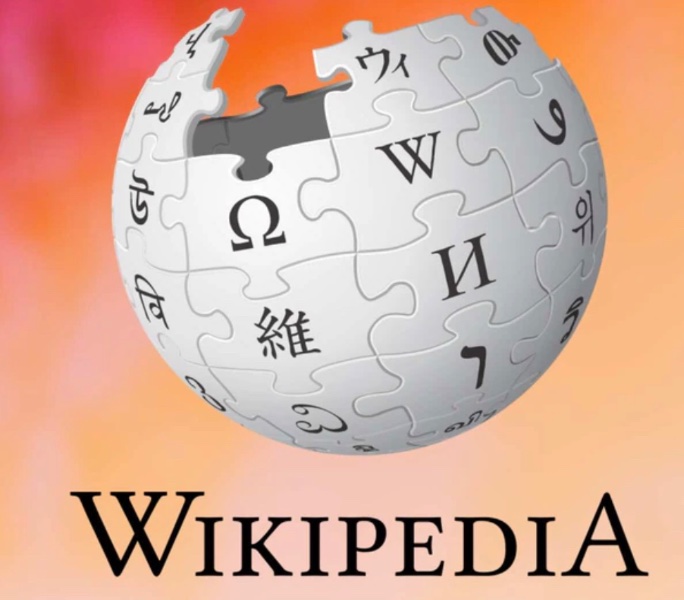
Yves GUÉCHI
Créée en 2001, Wikipédia s'est imposée comme la référence encyclopédique mondiale. Avec plus de 6,7 millions d'articles en anglais, 2,5 millions en français, et une centaine de langues représentées, le projet incarne à première vue un idéal : celui d'un savoir libre, universel, accessible et écrit par tous. Pourtant, derrière cette vitrine d'ouverture, se dessine une réalité bien plus complexe.
De nombreux contributeurs dénoncent aujourd'hui un fonctionnement opaque, contrôlé par une minorité ultra-active, qui impose sa vision de ce qui peut - ou non - entrer dans l'encyclopédie. Certains vont jusqu'à qualifier ce système d'élitiste, voire de sectaire. Enquête sur les coulisses de la plus consultée des encyclopédies.
Une minorité très active qui fait la loi
Contrairement à ce que laisse penser son principe fondateur - « l'encyclopédie que chacun peut améliorer » -, Wikipédia repose en réalité sur un noyau réduit de contributeurs. Selon les données de la Wikimedia Foundation, moins de 1 % des utilisateurs actifs effectuent plus de 75 % des modifications sur la plateforme.
Ces contributeurs chevronnés, parfois appelés « wikipédiens », connaissent parfaitement les règles du jeu. Ils maîtrisent les critères d'admissibilité, les procédures de suppression, les pages de discussion, les codes de mise en forme, et surtout, les rapports de force internes. Ils agissent souvent en modérateurs officieux, relisant, corrigeant, ou supprimant les contributions des autres.
Pour les nouveaux venus, le parcours peut vite devenir décourageant.
« J'ai voulu créer un article sur une personnalité scientifique peu connue, mais importante dans son domaine », raconte Marie*, chercheuse en biologie. « L'article a été supprimé en moins de 24 heures. On m'a dit que le sujet n'était pas admissible selon les critères. J'ai eu beau fournir des sources, rien n'y a fait. »
Des règles complexes, parfois arbitraires
Wikipédia repose sur plusieurs grands principes : la neutralité de point de vue, la vérifiabilité, l'interdiction du travail inédit, et l'obligation de s'appuyer sur des sources fiables. Des fondements nécessaires pour limiter les biais et éviter la désinformation. Mais dans leur application, ces règles laissent parfois place à des interprétations subjectives.
« Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des règles, c'est qu'elles sont appliquées de manière inégale », estime Julien, ancien administrateur de Wikipédia. « Ce qui passe pour un article peut être refusé ailleurs pour des raisons similaires. Beaucoup de décisions dépendent de qui intervient dans le débat. »
Les procédures de suppression sont également critiquées pour leur rapidité. Un article peut être supprimé sans préavis s'il est jugé non conforme. Et pour contester la décision, il faut engager une discussion communautaire, fréquemment technique et chronophage.
Un espace difficile d'accès pour les non-initiés
Ce fonctionnement favorise de fait les contributeurs expérimentés. Les novices, eux, doivent franchir une série d'obstacles : comprendre les attentes éditoriales, adopter le ton encyclopédique, savoir citer les bonnes sources, éviter toute impression de promotion personnelle. Une tâche d'autant plus ardue qu'un ton mal calibré ou une source jugée trop faible peut suffire à invalider un article entier.
Cette situation a vu naître un marché parallèle : celui des professionnels de Wikipédia. Agences de communication, rédacteurs spécialisés, consultants indépendants proposent désormais leurs services pour rédiger, corriger ou publier des articles dans les règles de l'art. Leur promesse : contourner les écueils du système et garantir une certaine stabilité à la page.
Une dérive paradoxale pour une encyclopédie qui se veut gratuite, ouverte et collaborative.
Les accusations d'élitisme se multiplient
La montée en puissance de ces services témoigne d'un malaise plus large. De nombreux observateurs dénoncent un entre-soi wikipédien. Une sorte de microcosme éditorial, peu représentatif de la diversité des savoirs ou des usages de la société.
« On est en train d'assister à une forme de confiscation du savoir », alerte une contributrice active qui souhaite rester anonyme. « Ce ne sont plus les compétences ou l'expertise sur un sujet qui priment, mais la capacité à manier les outils internes de la plateforme. »
En filigrane, la question de la légitimité. Pourquoi une poignée de bénévoles, sans toujours d'expertise dans les domaines concernés, auraient-ils le dernier mot sur la présence ou non d'un contenu encyclopédique ?
La Wikimedia Foundation rappelle de son côté que toute modification peut être discutée publiquement, et que le système repose sur un consensus communautaire.
Mais dans les faits, ce consensus est difficile à atteindre lorsqu'il faut affronter des contributeurs qui cumulent plusieurs milliers - voire dizaines de milliers - d'éditions à leur actif.
Des limites connues, mais peu débattues
Ces critiques ne sont pas nouvelles. Dès 2005, la revue Nature saluait la qualité de Wikipédia, tout en notant ses fragilités. Depuis, les controverses se sont multipliées : suppressions jugées abusives, conflits d'intérêts dissimulés, luttes d'influence sur certaines pages sensibles, etc.
Pour autant, Wikipédia reste massivement utilisée, et dans bien des cas, fiable. Des millions d'articles, souvent bien sourcés et régulièrement mis à jour, en font un outil précieux. Mais ce succès ne doit pas masquer les angles morts du système.
Peu de discussions publiques sont engagées sur les mécanismes internes de gouvernance. La Wikimedia Foundation, qui héberge la plateforme, adopte une posture neutre : elle fournit les moyens techniques, mais laisse la communauté gérer elle-même le contenu. Un choix qui renforce l'autonomie... et l'hermétisme de cette dernière.
Peut-on améliorer le modèle ?
Faut-il revoir les critères d'admissibilité ? Introduire davantage d'experts externes dans les prises de décision ? Rendre plus transparentes les suppressions ? La question de la réforme du modèle Wikipédia reste ouverte.
Plusieurs initiatives cherchent à contourner ses limites. D'autres plateformes, comme Citizendium ou Scholarpedia, misent sur une validation par des experts.
Des projets comme Wikiwand cherchent à améliorer l'expérience utilisateur. Mais aucun ne rivalise, à ce jour, avec l'audience et la puissance de Wikipédia.
Reste une alternative : renforcer la médiation. Offrir plus d'outils aux nouveaux contributeurs, faciliter l'intégration de contenus proposés par des institutions scientifiques ou culturelles, et surtout, encourager une culture du dialogue plutôt que de la sanction.
Un projet collectif à réinventer ?
Le paradoxe de Wikipédia est là : ce qui devait être une encyclopédie ouverte est en train de devenir un bastion éditorial. Non pas fermé par une logique commerciale, mais par une culture communautaire de plus en plus technique, procédurale, et difficile d'accès pour les non-initiés.
Le modèle fonctionne. Mais pour combien de temps ? Si la plateforme veut rester fidèle à sa vocation de départ - partager le savoir avec le plus grand nombre -, elle devra peut-être, un jour, s'interroger plus franchement sur sa gouvernance.
En attendant, le message est clair : pour contribuer efficacement à Wikipédia, il ne suffit plus de savoir. Il faut aussi - et surtout - savoir comment faire.
*Prénom modifié à la demande de la personne interrogée.