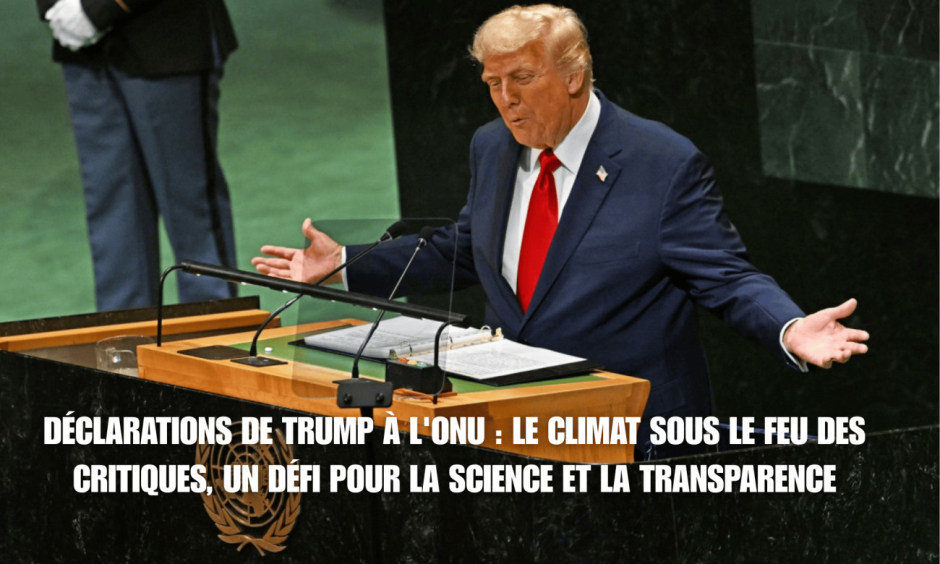Hier, lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump a une fois de plus secoué le monde diplomatique. Dans une allocution d'une heure, marquée par un ton combatif et des attaques frontales contre les institutions internationales, il a qualifié le changement climatique de « plus grande arnaque jamais perpétrée sur le monde » et le « empreinte carbone » d'une « farce inventée par des gens aux intentions malveillantes ». Ces propos, diffusés en direct, ont relancé le débat mondial sur l'urgence environnementale, tout en posant des questions profondes sur la transparence scientifique et les réactions internationales.
Le climat au cœur de la déclaration trumpienne
Trump n'a pas mâché ses mots. S'adressant aux chefs d'État et de gouvernement réunis à New York, il a dénoncé les politiques climatiques comme une « escroquerie verte » qui « redistribue la fabrication et l'activité industrielle des pays développés vers les pollueurs qui enfreignent les règles et s'enrichissent ». Il a moqué les énergies renouvelables - éolien et solaire - les qualifiant d'inefficaces et plus coûteuses que les combustibles fossiles, tout en revendiquant le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris comme une victoire pour l' « America First ». « Le changement climatique est un travail d'arnaqueurs », a-t-il lancé, affirmant que les prédictions de réchauffement global étaient erronées car « il a commencé à faire plus frais ». Ces affirmations, qui vont à l'encontre du consensus scientifique sur l'accélération du réchauffement climatique due aux activités humaines, ont été prononcées alors que les médias, sans relâche et sans débat véritable - hormis sur le consensus lui-même -, rabâchent, images à l'appui, que le monde bat des records de chaleur, d'incendies et d'inondations.
Ce discours s'inscrit dans la rhétorique de Trump, qui a déjà traité le climat de « canular » pendant sa première présidence. Mais, cette fois, devant l'ONU - bastion des efforts multilatéraux sur l'environnement -, ses mots résonnent, pour les globalistes, comme un rejet pur et simple de la coopération globale. Il a accusé l'organisation d'écrire des « lettres fortes » sans effet concret, tout en vantant la domination énergétique américaine basée sur le pétrole et le gaz.
Conséquences pour la transparence et la science : un coup porté au consensus mondial
Les déclarations de Trump ne se contentent pas de contredire les éléments avancés comme « faits et vérités » par experts et médias réunis. Les déclarations de Trump viennent miner la transparence et la crédibilité de la science climatique qui s'appuie sur le « consensus ». Des fact-checks immédiats, comme celui d'ABC News, se sont évertués à démonter ses affirmations sans toutefois engager un réel débat contradictoire : les énergies renouvelables sont désormais moins chères que les fossiles dans de nombreux contextes (tout en oubliant les subventions et le cout de remise en état des sites imposé par la loi pollueur payeur). Et, le retrait de Paris a coûté aux États-Unis des opportunités économiques et diplomatiques. En qualifiant les experts de « stupides » et les initiatives onusiennes de « fausses », Trump prend une position ferme perçue comme alimentant la défiance envers les données scientifiques, issues d'organismes comme le GIEC. Elles reposent sur des milliers d'études peer-reviewed, auxquelles de nombreuses voix scientifiques s'opposent, à commencer par Steven Koonin l'ancien conseiller d'Obama.
Les critiques au discours de Trump évoquent « des répercussions profondes ». Sur le plan de la transparence, ils avancent qu'elle obscurcit les débats publics en favorisant les narratifs simplistes au détriment des nuances scientifiques. Pour la science elle-même, elle risque de décourager les investissements dans la recherche, comme l'a averti le New York Times, qui note que le monde doit « affronter le changement climatique, qui n'est pas sous contrôle, et l'effondrement de la biodiversité ». À l'heure où les sommets climatiques se multiplient - avec une conférence majeure prévue au Brésil en novembre -, les propos de Trump pourraient isoler les États-Unis, affaiblissant les efforts globaux pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. En somme, cet appel à la souveraineté nationale qui selon ses observateurs « sacrifie la transparence internationale », l'est potentiellement effectué au prix d'une urgence environnementale non résolue. Le débat vient donc d'être relancé.
Les réactions : de l'embarras à l'applaudissement
Les réactions n'ont pas tardé, reflétant la polarisation profonde autour de Trump. Dans la salle de l'ONU, les applaudissements ont été tièdes, avec des grognements audibles lors des attaques sur le climat, selon des témoins cités par Reuters. Les médias internationaux ont qualifié le discours d' « embarrassant » et de « honte pour l'Amérique », le Washington Post soulignant qu'il « ridiculise les valeurs de l'ONU » en ignorant les souffrances causées par les catastrophes climatiques. Tout est fait pour défendre le narratif du climat, peu importe les faits qui viendraient s'y opposer, ou les experts qui demandent le débat.
La machine médiatique est en place au même titre qu'elle a été déclenché la veille pour contrer les déclarations de Trump et son secrétaire d'Etat à la Santé, Robert Kennedy Jr, sur les liens présumés entre l'autisme et le paracétamol.
Sur les réseaux sociaux, le fossé est criant de réalisme, ces vérités que l'on n'entend pas sur les médias mainstream dont les journalistes et rédactions s'imposent des chartes Climat & Environnement ! Les soutiens MAGA acclament : « les environnementalistes volent en jet privé puis prétendent être verts », ou décrivent ce « discours comme étant génial et important » qui dénonce les « arnaques vertes ». À l'opposé, des voix se mettent à prier pour « le vol démocratique de Trump » sans toutefois évoquer la pression mise sur ce narratif pendant des années, et d'autres s'étonnent de « sa détermination à dire l'opposé de la vérité ».
Des leaders mondiaux, via des déclarations relayées par Al Jazeera, ont critiqué l'approche isolationniste, un dirigeant européen anonyme murmurant que « les pays vont en enfer » si on suit ce chemin. Des alliés comme Marco Rubio, secrétaire d'État, ont salué un « modèle pour le monde libre », et les fact-checks de CNN et The Guardian s'empressent de lister au moins cinq mensonges flagrants sur le climat, l'immigration et la paix mondiale, toujours avec l'absence de débat.
Globalement, le discours a ravivé les tensions : loué par les climatosceptiques comme un « triomphe », il est vu par les progressistes comme une « moquerie des valeurs onusiennes », selon The Guardian.
Réactions dans les médias français : une condamnation unanime du déni climatique
En France, les médias ont réagi avec une virulence particulière, voyant dans les propos de Trump une menace directe pour les efforts européens en matière de climat et de multilatéralisme. Rappelons que les journalistes et rédactions français ont signé en nombre une charte éditoriale environnementale ! Le site internet de cette charte, lancé en grande pompe le 14 septembre 2022 et signée par les rédactions et plus de 1500 journalistes, a soudainement disparu des radars le 31 aout 2025. Le Monde allant même jusqu'à se doter de sa propre charte Climat et Environnement. La meilleure illustration étant la censure d'Adèle Van Reeth sur le service public qui justifiait ainsi ne pas inviter des experts s'opposant à la thèse du dérèglement climatique.
France 24 a titré sur « la plus grande arnaque de l'Histoire », soulignant comment Trump s'en prend frontalement à la science du climat, qualifiant ses affirmations d' « insultes aux experts » et d'un « recul dangereux » alors que l'Europe mène la charge sur les transitions énergétiques. France Info a mis en avant la charge contre l'Europe, accusée de « suicider son économie » par des politiques climatiques « arnaqueuses », et a interviewé des diplomates français qui parlent d'un « discours qui fragilise l'Alliance atlantique sur l'environnement ».
La Croix et Ouest-France ont soi-disant décortiqué le « déni climatique » et les « mensonges » égrenés par Trump, avec La Croix, notant que son rejet de l'Accord de Paris « ignore les catastrophes actuelles en Europe, comme les inondations en France ». Libération va plus loin, accusant Trump de « relever le déni » en reprenant « les éléments de langage des climatosceptiques », et cite des ONG françaises qui le qualifient d' »insulte au GIEC et à la science ». Le Parisien rapporte la riposte d'Emmanuel Macron, qui a défendu l'ONU en fustigeant le « cynisme de Trump : « Si cette assemblée est inefficace, c'est que quelques-uns la bloquent », une pique directe au président américain.
Radio France et Le Nouvel Obs, sans rappeler la charte éditoriale signée sur le sujet climatique qui enferme le débat, évoquent une « charge violente » contre l'ONU et l'Europe, destinée « en enfer » selon Trump, avec un climatoscepticisme « répété et désinhibé » qui « mine la coopération globale ». Sur les réseaux, des émissions comme C à vous sur France 5 s'evertuent à décrypter un « festival de fanfaronnades et d'accusations mensongères », tandis que Le Figaro relaie les citations choc sur l'empreinte carbone comme « supercherie ».
Globalement, la presse française voit dans ce discours un « froid glacial » jeté sur les négociations climatiques, renforçant l'isolement américain et appelant à une « riposte européenne unie ».
Aucun journaliste, probablement tenu par les chartes Climat et Environnement adoptées par de nombreux médias français, ne semble s'interroger sur les données alternatives, préférant adhérer au consensus scientifique dominant.On a l'impression que les leçons tirées des erreurs récentes de l'histoire - notamment sur la gestion de la Covid-19, avec les débats persistants sur l'efficacité réelle des mesures de distanciation sociale face à leurs impacts sur la santé mentale et les libertés, ou sur les bénéfices nets des vaccins covid au regard de leurs risques d'effets secondaires graves, comme la myocardite ou les thromboses - n'ont pas pénétré les rédactions françaises ni l'esprit de leurs plumes.
Cela, malgré les principes de la Charte de Munich, qui impose aux professionnels de l'information de respecter la vérité, de promouvoir le pluralisme et d'inviter au débat des idées, quoi qu'il en coûte.
Un débat relancé, des jours historiques de bascule
Les déclarations de Trump à l'ONU ne sont pas un événement isolé : elles s'inscrivent dans une séquence explosive du 22 et 23 septembre 2025, des jours à marquer d'une pierre blanche, où les narratifs dominants sur la santé, la censure et le climat ont été brutalement mis à jour.
Le 22 septembre, Trump et Robert F. Kennedy Jr. ont tenu une conférence à la Maison Blanche liant l'usage du paracétamol pendant la grossesse à l'épidémie d'autisme, annonçant des étiquettes d'avertissement sur le Tylenol et relançant le débat sur les vaccins - 40 à 70 % des mères d'enfants autistes y voyant un lien, selon Kennedy. Le lendemain, l'aveu de Google devant le Congrès américain : la firme a censuré du contenu COVID-19 sous pression de l'administration Biden, sans violation de ses propres règles, promettant de lever des bans et d'abandonner les fact-checkers biaisés. Cela expose une collusion entre Big Tech et le pouvoir, ébranlant la confiance dans l'information en ligne. Enfin, le discours de Trump sur le climat boucle cette trilogie : en dénonçant une « arnaque », il force un réexamen des politiques vertes, souvent accusées d'hypocrisie.
Ces 48 heures marquent une bascule : le narratif de la santé publique (autisme masqué par le paracétamol), de la censure (aveu de Google sous pression politique) et du climat (canular ou urgence ?) est fissuré. Le débat est vraiment relancé - non plus entre faits et fiction, mais entre souveraineté et manipulation globale. L'Histoire retiendra ces jours comme un tournant, où le réalisme a pris le pas sur les consensus imposés.Ces vérités de groupe, que l'on ne pouvait plus évoquer au nom de l'uniformité des chartes éditoriales, vont devoir être débattues.
Reste à voir si cela mènera à une transparence accrue... ou à plus de chaos.